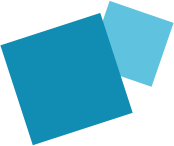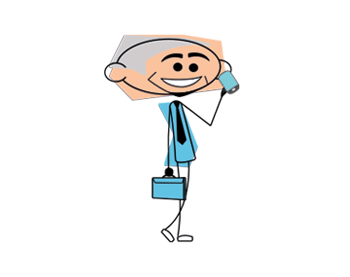
Syndics immobiliers : devez-vous procéder au relevé des compteurs privatifs ?

Relever les compteurs privatifs n’est pas une mission du syndic !
Un copropriétaire est victime d’une surconsommation d’eau provoquée par une fuite. Il demande alors gracieusement au service d’assainissement de la ville de lui faire une remise. Mais sa demande est rejetée.
Mécontent, il se retourne alors contre le syndic chargé de gérer la copropriété. Il considère que le syndic, chargé d’administrer l’immeuble, aurait dû relever le compteur d’eau de son appartement et l’informer de la surconsommation.
Ce que réfutent le syndic… et le juge ! Ce dernier rappelle que le syndic immobilier est tenu d’administrer les parties communes de la copropriété et non les parties privatives. Or, le compteur d’eau du copropriétaire est privatif. Dès lors, le syndic n’était pas tenu de procéder au relevé du compteur d’eau. Il ne doit donc pas indemniser le copropriétaire.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 décembre 2016, n° 15-25305
Immobilier : un compromis est-il une « vente parfaite » ?

Un compromis est une « vente parfaite », sous conditions suspensives…
Une personne qui a mis en vente sa maison trouve un acquéreur, par le biais d’un agent immobilier, et signe un compromis de vente. Mais l’acte authentique de vente devant être conclu chez le notaire n’est jamais signé, l’acquéreur ne voulant plus acheter la maison.
L’agent immobilier poursuit alors en justice l’acquéreur afin de percevoir sa rémunération. Le vendeur fait de même pour que soit constaté que la vente est « parfaite ».
L’acquéreur, pour se justifier, explique que s’il refuse de signer l’acte de vente chez le notaire, c’est parce qu’il existe un différend sur la limite de la propriété. De plus, il rappelle qu’un bornage devait avoir lieu afin de mettre un terme à ce différend. N’ayant jamais été informé de la réalisation du bornage, il considère que la vente est caduque…
… à tort pour le juge. Parce que les limites de copropriété n’ont pas été érigées en condition notable du compromis et que le bornage n’était pas une condition suspensive du contrat, la vente est « parfaite ». L’acquéreur ne peut donc pas se prévaloir d’un différend sur la limite de propriété pour refuser de signer l’acte de vente chez le notaire. L’agent immobilier a donc droit à sa rémunération.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 janvier 2017, n° 15-14894
Copies numériques de documents de santé : ont-elles une valeur juridique ?

Une copie numérique d’un document de santé est fiable si…
Les copies numériques d’un document de santé peuvent avoir la même valeur que le document original si, comme toutes copies, elles remplissent les conditions de fiabilité posées par la Loi.
Ainsi, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps, cette copie numérique devant, en outre, indiquer sa date de création et comporter un horodatage, un cachet ou une signature électronique attestant ainsi sa validité.
Mais s’agissant des conditions de reconnaissance de fiabilité des copies numériques d’un document de santé, la Loi est un peu plus précise. Il est ainsi précisé que la signature apposée par le patient signifie qu’il a pris acte du contenu et, le cas échéant, y consent ; la signature du professionnel de santé a pour effet de valider le contenu du document.
En outre, il est précisé qu’à la demande des patients, vous pouvez centraliser sur un document les données de santé à caractère personnel contenues dans plusieurs documents numériques existants. Il faut que ce document centralisateur ne modifie ni le sens ni le contenu des données et respecte le secret médical et ainsi que la confidentialité des données collectées et traitées.
Le document centralisateur ainsi créé est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'a été utilisé un procédé de production permettant d'insérer les métadonnées nécessaires à la garantie de l'identification de l'émetteur et de l'intégrité des données ainsi matérialisées.
Source : Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique
Copies numériques de documents de santé : ont-ils une valeur juridique ? © Copyright WebLex - 2016

ICPE : l’autorisation doit être conforme au plan local d’urbanisme (PLU) !

L’autorisation peut être validée… a posteriori !
Une société obtient de la Préfecture l’autorisation nécessaire pour pouvoir exploiter une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Toutefois, la Mairie où se trouve l’installation classée demande l’annulation de l’autorisation : selon elle, l’autorisation a été délivrée en violation des règles prévues par le plan local d’urbanisme (PLU).
Annulation que conteste la société. Si elle reconnaît que l’autorisation a été délivrée en violation des règles prévues par le PLU, elle rappelle que depuis, le PLU a été modifié et que l’autorisation respecte les nouvelles règles qu’il contient. Dès lors, elle considère que l’autorisation ne doit pas être annulée.
Argumentation que rejette la Mairie : pour elle, il faut apprécier la légalité de l’autorisation au regard du PLU en vigueur au moment où elle a été délivrée.
Le juge n’est pas d’accord avec la Mairie. Il rappelle que pour être valable, l’autorisation doit être conforme au PLU de la commune où doit être implantée l’ICPE. Par conséquent, une autorisation délivrée en violation des règles prévues par le PLU peut être annulée. Toutefois, si entre temps, les règles du PLU ont changé et que l’autorisation est valide au regard des nouvelles règles qu’il contient, l’autorisation n’a pas à être annulée. Ce qui est le cas dans cette affaire. La demande d’annulation de l’autorisation par la Mairie est donc rejetée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 décembre 2012, n° 391452
ICPE : l’autorisation doit être conforme au plan local d’urbanisme (PLU) ! © Copyright WebLex - 2016

Libre installation des notaires : les modalités du tirage au sort sont (enfin) connues !

Libre installation des notaires : un tirage au sort (très) encadré !
Les modalités du tirage au sort des notaires dans les zones d’installation libre sont précisées. Vous devez savoir, tout d’abord, que ce tirage au sort a lieu lorsque dans les 24 heures qui suivent la date d’ouverture du dépôt des demandes de création d’office, le nombre de ces demandes est supérieur aux recommandations de la Chancellerie. Cet écart supérieur est alors retranscrit en pourcentage.
Il est alors procédé au tirage au sort : l’ordre de réalisation des tirages au sort est déterminé par zone d’installation libre et par ordre croissant des écarts, exprimé en pourcentage. Cet ordre est publié sur le site Internet du Ministère de la justice au moins 5 jours avant la date de réalisation du 1er tirage au sort.
La nouvelle réglementation précise également la qualité des personnes qui organisent et participent aux opérations de tirage au sort. Retenez que seront notamment présents un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif, un rapporteur de l'Autorité de la concurrence et des représentants du Conseil Supérieur du Notariat (CSN).
Pour mémoire, lors du dépôt de vos demandes, vous devez remplir un bulletin qui sera anonymisé. Ce bulletin sera ensuite placé dans une urne opaque par le 1er secrétaire de séance et les opérations de tirage au sort pourront commencer. Le tirage sera effectué manuellement par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence. Chaque tirage devra faire l’objet d’un procès-verbal, signé par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence et par le magistrat et le représentant du CSN ayant assisté aux opérations de tirage au sort.
Source : Arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Libre installation des notaires : les modalités du tirage au sort sont (enfin) connues ! © Copyright WebLex - 2016

Transporteurs : l’arrivée au port signifie-t-elle la fin de la mission ?

Transporteurs : mission non terminée, responsabilité toujours engagée !
Une société est chargée d’effectuer le transport maritime de pièces de rechange pour matériel de guerre depuis Odessa jusqu’à Alger. Le voyage se passe sans problème et la marchandise est livrée au port d’Alger.
Un prestataire qui a récupéré la marchandise commence alors à enlever les conteneurs du bateau. Mais en retirant l’un des conteneurs, un autre tombe à la mer, endommageant la marchandise. Le destinataire de la marchandise demande alors réparation du préjudice subi. Il se retourne donc contre l’expéditeur des pièces de rechange pour matériel de guerre qui le rembourse. L’expéditeur demande ensuite des comptes à la société de transport.
Cette dernière refuse d’indemniser l’expéditeur. Elle rappelle que lorsque le conteneur est tombé à la mer, elle avait déjà livré la marchandise. Elle considère donc que sa mission était terminée et que sa responsabilité n’est pas engagée.
« Faux » selon l’expéditeur. Ce dernier explique que la mission de la société ne se limitait pas au simple transport de la marchandise. La société devait, en effet, également retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux. Or, la société en a laissé un, et c’est ce verrou oublié qui a causé la chute d’un des conteneurs dans la mer. Dès lors, l’expéditeur considère que la mission de la société n’était pas totalement terminée et que sa responsabilité est engagée.
Ce que valide le juge : la mission de la société de transport n’était pas terminée puisque les verrous n’avaient pas tous été enlevés et la livraison ne pouvait donc pas être considérée comme intervenue au moment de la chute du conteneur. La société de transport doit donc indemniser l’expéditeur à hauteur de 80 000 droits de tirage spéciaux dans cette affaire (pour mémoire les droits de tirage spéciaux (DTS) sont un instrument monétaire utilisé dans le commerce international).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, n° 14-24018 et 15-17130
Transporteurs : l’arrivée au port signifie-t-elle la fin de la mission ? © Copyright WebLex - 2016

Décision judiciaire : faire appel… par internet ?

Il est possible de faire appel par internet mais en passant par un avocat !
Une salariée considère que sa rémunération a été injustement diminuée par son employeur. Elle décide donc de poursuivre son employeur devant le juge des prud’hommes. La décision des juges ne l’ayant pas satisfaite, elle a décidé de faire appel… que l’employeur considère comme étant irrecevable : il estime, en effet, que le principe d’égalité devant la justice, reconnu à chaque justiciable, a été rompu.
Il constate que l’avocat de la salariée a déposé sa déclaration d’appel par voie électronique, via le Réseau privé virtuel des avocats. Or, selon lui, une déclaration d’appel doit être faite ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour. Parce qu’un justiciable qui souhaiterait se défendre seul (sans avocat) ne peut pas avoir accès au Réseau privé virtuel des avocats, il est donc privé d’un moyen supplémentaire de faire appel d’une décision de justice. Situation qui caractérise une rupture d’égalité devant la justice, selon l’employeur…
… à tort selon le juge ! Les actes de procédure peuvent être faits par voie électronique, à condition qu’ils respectent les modalités fixées par la Loi. Or, la déclaration d’appel qui a été adressée par l’avocat de la salariée respectait les formalités légales imposées : indication du nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des deux parties, ainsi que l’objet de la demande, et la copie de la décision contestée, la date et la signature. La déclaration d’appel est donc recevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2017, n° 14-29013
Décision judiciaire : faire appel… par internet ? © Copyright WebLex - 2016

Attention à la rédaction des clauses de garantie

Une clause mal rédigée profite au client !
Un particulier prend en location une voiture utilitaire auprès d’une société de location. A cette occasion, il souscrit à l’option de garantie que propose la société. Lorsqu’il restitue la voiture, à la fin de la location, celle-ci est endommagée à divers endroits. La société fait réparer la voiture et demande le remboursement des frais engendrés par les travaux de réparation à son client (soit 7 000 € dans cette affaire). Mais le client refuse, opposant la garantie souscrite.
Garantie que la société estime inopposable. Elle rappelle qu’aux termes de la garantie, le client est pleinement responsable des dommages causés à la partie haute du véhicule. Toutefois, son client remarque qu’à la fin de la clause, il est indiqué que sa responsabilité est limitée au montant de la franchise contractuelle. La clause n’étant ni claire, ni compréhensible, il estime qu’elle doit être interprétée à son avantage.
Le juge lui donne raison : dès lors qu’il y a une contradiction entre la mention de pleine responsabilité et celle restreignant la responsabilité au montant de la franchise contractuelle, la clause doit être interprétée en faveur du client. Il rappelle, en effet, que les clauses des contrats proposés par des professionnels à un client particulier ou considéré comme « non-professionnel » doivent être interprétées en faveur de ces derniers. La responsabilité du client est donc ici limitée à la franchise contractuelle de 900 €, le reste des travaux, soit 6 100 €, incombant à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017, n° 15-25479
Attention à la rédaction des clauses de garantie ! © Copyright WebLex - 2016

Contrat de location : la clause de solidarité entre colocataires est-elle valable ?

Clause de solidarité limitée dans le temps = clause valable !
Un couple signe un bail d’habitation avec un bailleur pour un appartement. Après 1 an de colocation, le couple se sépare et la concubine quitte l’appartement, après avoir dûment envoyé son congé au bailleur.
2 ans plus tard, elle reçoit un courrier de la part du bailleur : son ancien compagnon, qui est toujours locataire de l’appartement, ne paye plus le loyer dû. Le bailleur lui demande donc de payer les loyers impayés, lui rappelant la clause de solidarité inscrite dans le contrat location signé.
Impayés qu’elle refuse de rembourser : elle considère que la clause de solidarité est discriminatoire et abusive. Pour elle, la clause de solidarité qui ne vaut que pour les « colocataires », statut qu’elle et son ex-compagnon avaient lors de la conclusion du bail est discriminatoire car elle prévoit une situation plus défavorable que pour les couples mariés ou liés par un Pacs. De plus, la clause est abusive car elle introduit un déséquilibre entre elle et le bailleur, en faveur de ce dernier.
Clause parfaitement valable pour le bailleur : il rappelle qu’aux termes du contrat, la solidarité entre les colocataires prend fin 3 ans après la réception de la lettre congé. Les 3 ans ne s’étant pas encore écoulés, il estime que la solidarité est donc applicable et valable.
Ce que valide le juge : parce que la clause est limitée dans le temps, elle n’est ni discriminatoire ni abusive. L’ex-concubine doit donc rembourser les loyers impayés.
Cette décision a été rendue pour un bail conclu avant l’entrée en vigueur de la Loi Alur. Pour rappel, une mesure de la Loi Alur prévoit que la clause de solidarité prend fin à la date d'effet du congé lorsqu’un nouveau colocataire entre dans les lieux. A défaut, la solidarité du colocataire sortant prend fin 6 mois après la prise d’effet du congé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 16-10324
Contrat de location : la clause de solidarité entre colocataires est-elle valable ? © Copyright WebLex - 2016

Pacte d’associés = contrat d’honneur ?

Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !
Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.
15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.
Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».
Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.
Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613