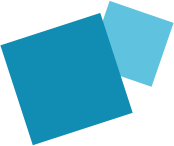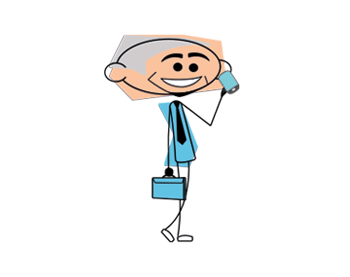
Homologation d’une rupture conventionnelle : quand l’administration change d’avis…

Le refus d’homologation ne crée aucun droit pour personne
Une entreprise conclut une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie. Une fois le délai de rétractation de 15 jours expiré, sans que le salarié, ni l’employeur, n’aient manifesté leur volonté de se rétracter, la convention est adressée à l’administration (à la Direccte, pour être plus précis).
Cependant, parce que les salaires n’ont pas été reconstitués pendant la période d’arrêt maladie, ne permettant donc pas le calcul de l’indemnité de rupture, la Direccte refuse d’homologuer la convention. L’employeur lui adresse alors une attestation, que l’administration considère suffisante pour homologuer la convention. Elle revient donc sur sa décision première et valide la rupture conventionnelle.
Mais le salarié estime que seule la 1ère décision de l’administration compte. Le refus d’homologation empêchant la rupture du contrat, d’après lui, la rupture qui a suivi la 2ème décision de l’administration doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pourtant, le juge valide la rupture conventionnelle du contrat de travail : il précise que le refus d’homologation de la convention ne crée aucun droit, ni pour le salarié, ni pour l’employeur, ni pour les tiers. De ce fait, la décision de rejet de l’administration peut être retirée par son auteur.
Cette décision semble indiquer que le salarié, tout comme l’employeur, ne peut plus changer d’avis une fois le délai de rétractation expiré. A moins, bien sûr, que le consentement du salarié n’ait pas été donné de manière libre et éclairé.
Source : Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2017, n° 15-24220 et n° 15-24221
Homologation d’une rupture conventionnelle : quand l’administration change d’avis… © Copyright WebLex - 2017

Licenciement nul d’un salarié protégé : combien ça coûte ?

Une indemnité sans réintégration du salarié
Une entreprise est condamnée par le juge à devoir résilier le contrat de travail d’une salariée « aux torts de l’employeur ». Comme cette salariée est aussi déléguée du personnel, cette forme de rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul.
Dans ce cas, la salariée peut demander à réintégrer l’entreprise. Ce qu’elle n’a pas souhaité dans cette affaire. De ce fait, elle peut prétendre à une indemnité pour violation de son statut protecteur. Cette indemnité est égale à la rémunération qu'elle aurait normalement perçue entre la date du licenciement et l'expiration de la période de protection, celle-ci expirant 6 mois après le terme du mandat.
Le mandat de la salariée était d’une durée de 4 ans. A la date de la rupture du contrat, il lui restait 3 ans de mandat à accomplir. De ce fait, elle réclame une indemnisation correspondant à 3 ans et demi de rémunération : les 3 ans du mandat restants, augmentés de la prolongation de la protection.
Indemnisation que lui refuse le juge… du moins en partie : l’indemnité est égale à la rémunération qu'elle aurait normalement perçue entre la date du licenciement et l'expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans correspondant à la durée minimale du mandat du délégué du personnel, augmentée de 6 mois (période de prolongation de la protection).
Cette méthode de calcul permet de limiter les indemnités qu’un employeur aurait à verser à un salarié en pareil cas.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mai 2017, n° 15-18719
Licenciement nul d’un salarié protégé : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2017

Un accident pendant un jeûne : qui est responsable ?

Des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés
Au préalable, rappelons que vous êtes tenu, en toutes circonstances, d’une obligation de sécurité qui vous impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé mentale et physique des salariés et prévenir la pénibilité du travail.
En outre, lorsqu’un de vos salariés est victime d’un accident de travail, cet accident va impacter votre taux de cotisation afférant au risque « accident du travail / maladies professionnelles ».
De ce fait, pour remplir votre obligation de sécurité, vous devez :
- mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- mettre en œuvre des actions d'information et de formation ;
- mettre en place une organisation et des moyens adaptés.
Vous pouvez donc communiquer régulièrement sur les potentiels risques relevés dans votre entreprise et informer vos salariés du possible accroissement de ces risques en période de jeûne.
Enfin, pour limiter les risques d’accidents, vous pouvez adapter les conditions de travail des salariés. Pour ce faire, vous pouvez donc envisager un aménagement du temps de travail des salariés concernés par le jeûne, pour leur permettre de se reposer davantage.
Si votre entreprise est pourvue d’un CHSCT, celui-ci pourra être un allié dans vos démarches de prévention. Dans tous les cas, le service de santé au travail pourra vous aider à explorer des pistes pour assurer la prévention des risques d’accidents.
Source : Articles L 4121-1 et L 4141-1 et suivants du Code du Travail
Santé et sécurité au travail : quand la faim justifie les moyens… © Copyright WebLex - 2017

Travailler dans le Bâtiment : langue française exigée ?

La « clause Molière » : interdite ?
Lors d’un appel d’offres publiques, certaines collectivités locales exigent des entreprises candidates que leurs salariés soient capables de parler et de comprendre le français. Cette exigence est couramment appelée « clause Molière ».
Cependant, les Ministres de l’intérieur, du travail, de l’économie et de l’aménagement du territoire ont précisé que cette exigence est illégale. Ils ont donc ordonné aux Préfets de veiller à ce qu’aucune collectivité ne puisse imposer cette condition aux entreprises candidates aux marchés publics.
Ainsi, si une collectivité récalcitrante maintenait cette condition, vous pourriez en faire part au Préfet qui pourra alors faire annuler l’acte « illégal ».
- Instruction interministérielle du 27 avril 2017 relative aux délibérations et actes des collectivités territoriales imposant l’usage du français dans les conditions d’exécution du marché
Respect de la durée maximale du travail : qui doit le prouver ?

La charge de la preuve n’est pas partagée !
Un employeur est mis en cause par un salarié pour n’avoir, d’après ce dernier, pas respecté la durée maximale hebdomadaire du travail et les durées minimales de repos.
Pour rappel, la durée maximale du travail est de 48 heures par semaines. Mais au cours de la semaine, le salarié doit bénéficier d’au moins 11 heures de repos quotidien et de 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures).
Dans cette affaire, l’employeur demande au salarié de fournir des éléments qui confirmeraient son reproche. Il estime que, comme en matière de contestation sur la réalisation d’heures supplémentaires, la charge de la preuve doit être partagée.
Mais ça n’est pas le cas, rappelle le juge. Le respect des seuils (en termes de repos) et des plafonds (en matière de durée du travail) s’impose à l’employeur et c’est à lui de prouver, en cas de désaccord, qu’il a satisfait à ses obligations.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507
Réintégration d’un salarié protégé : une nouvelle protection ?

Une prolongation de la protection : à partir de quand ?
Une entreprise obtient l’autorisation de l’inspection du travail de licencier pour motif économique une salariée déléguée du personnel. Cette dernière, contestant son licenciement, a alors exercé un recours contre la décision de l’inspecteur du travail. Décision qui a finalement été annulée… 6 mois plus tard, alors que le licenciement a déjà été prononcé.
La salariée a donc souhaité réintégrer l’entreprise. Cependant, le poste de la salariée avait été supprimé et l’établissement fermé (raison du licenciement économique). L’employeur lui propose donc immédiatement un poste disponible… que la salariée refuse. Environ 7 mois plus tard, un emploi se libère, équivalent à celui que la salariée occupait avant son licenciement.
Mais celle-ci refusant ce nouveau poste, l’employeur la licencie immédiatement, sans demander l’autorisation de l’inspecteur du travail, cette fois : d’une part, l’instance des délégués du personnel a été renouvelée avant l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail, privant la salariée du statut protecteur de son mandat ; d’autre part, il estime qu’au moment de la 2ème proposition d’emploi, la prolongation de protection de 6 mois avait de toute façon expiré.
Ce que conteste la salariée au motif que la protection de 6 mois dont elle doit bénéficier dans le cadre de sa réintégration a pour point de départ sa réintégration effective ou du moins le jour où l’employeur lui a proposé un emploi équivalent à celui duquel elle a été licenciée. Or, seule la 2ème proposition remplissait cette condition.
Ce que confirme le juge : la protection de 6 mois ne débute que lorsque l’employeur propose au salarié de réintégrer un poste équivalent (en termes de rémunération, de qualification, de perspectives de carrière et de secteur géographique) à celui qu’elle occupait mais qui a été supprimé. Dans cette affaire, la salariée était protégée pour 6 mois de plus au moment de la 2nde proposition d’emploi. L’employeur aurait donc dû obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2017, n° 14-29610
Réintégration d’un salarié protégé : une nouvelle protection ? © Copyright WebLex - 2017

Aide à l’embauche PME : bientôt la fin…

Recrutez avant le 30 juin 2017 pour bénéficier d’une aide !
L’aide à l’embauche dans les PME est un dispositif encourageant l’embauche en CDI, ou en CDD d’une durée d'au moins 6 mois, ou en contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois.
L’aide est d’un montant de 4 000 € pour un équivalent temps plein (proratisé pour un temps partiel), versée trimestriellement sur 2 ans par tranches de 500 € maximum.
Pour en bénéficier, la rémunération du salarié ne doit pas dépasser 1,3 SMIC (ou 1,3 salaire minimum garanti à Mayotte).
Le contrat de travail doit prendre effet avant le 30 juin 2017. Sachez, par ailleurs, qu’après un CDD ayant ouvert le droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 6 mois ou l’embauche en CDI avant le 30 juin 2017 permettra le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal.
Si vous remplissez ces conditions, vous devez faire une demande d’aide auprès de l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent l’embauche.
Source :
- Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises
- Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises
Aide à l’embauche PME : bientôt la fin… © Copyright WebLex - 2017

Peut-on supprimer le poste d’un salarié victime d’un accident de travail ?

Une impossibilité de maintenir le contrat de travail ?
Une entreprise, placée en redressement judiciaire, a obtenu l’autorisation du juge-commissaire de supprimer 2 postes. L’un de ces postes est habituellement occupé par un salarié actuellement en arrêt à la suite d’un accident de travail.
L’entreprise prononce donc le licenciement de ce salarié pour motif économique. Licenciement nul, pour le salarié : il rappelle qu’il n’est pas possible de licencier un salarié en arrêt de travail occasionné par un accident du travail, sauf en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident de travail.
Pour sa défense, l’employeur rappelle alors que le motif économique, mentionné dans la lettre de licenciement, est bien un motif étranger à l’arrêt de travail. Il souligne que la lettre précise que la suppression de son poste présente un caractère urgent, inévitable et indispensable, qu’elle a été autorisée par le juge-commissaire en raison, notamment, d’une importante baisse du chiffre d'affaires, de la constitution d'un stock trop conséquent et de comptes largement déficitaires.
L’employeur considère donc que ces causes justifient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à son accident de travail et que la lettre de licenciement qui les mentionne est suffisamment motivée.
Position qui n’est pas adoptée par le juge, lequel sanctionne l’employeur en invalidant le licenciement. En cause, un problème de forme : il constate que la lettre de licenciement ne mentionne tout simplement pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à son accident de travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-12232
Peut-on supprimer le poste d’un salarié victime d’un accident de travail ? © Copyright WebLex - 2017

RTT non pris : pas d’indemnité sans rupture du contrat ?

Un report de la quote-part des repos possible ?
Lorsque vos salariés travaillent au-delà de 35 heures, ils accomplissent des heures supplémentaires. Il est possible de compenser les heures travaillées par des jours de repos compensateur. De même, lorsque les heures supplémentaires accomplies par vos salariés dépassent un contingent annuel, déterminé par un accord collectif ou, à défaut, fixé à 220 heures par an, ils bénéficient d’un repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos).
Dans une affaire, une salariée, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, a utilisé ses heures de délégation pendant qu’elle était justement en repos compensateur. Elle a alors demandé à son employeur de lui payer une indemnité en remplacement du repos non pris. Ce qu’a refusé l’employeur…
… et confirmé le juge : tant que le contrat de travail n’est pas rompu, la salariée peut demander le report de ses jours de repos compensateurs mais pas le paiement de l’indemnité correspondante. Il précise même que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ce repos, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu'il reçoit une indemnité correspondante.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n°15-25250
RTT non pris : pas d’indemnité sans rupture du contrat ? © Copyright WebLex - 2017

Salarié joignable à tout moment = salarié en astreinte ?

Astreinte ou horaires discontinus : quelle différence ?
Un salarié réclame un repos compensateur pour compenser ce qu’il estime être des astreintes. A l’appui de sa demande, il rappelle qu’il a effectué des heures de travail non planifiées : selon lui, parce qu’il était alors susceptible d’intervenir à tout moment, il était effectivement en situation d’astreinte.
Mais, pour l’employeur, les interventions réalisées par le salarié ne constituaient pas des astreintes. Au contraire, il travaillait en horaires discontinus. Voilà pourquoi il a dû travailler, certains jours, à plusieurs moments de la journée, entrecoupés de pauses plus ou moins longues dans le cadre de ce qui est appelé dans l’entreprise des « assistances non programmées ».
Il considère, en outre, que l’astreinte ne peut pas être caractérisée par le seul fait que le salarié ait pu être joignable en dehors de ses heures de travail, d’autant que les « assistances non programmées » nécessitant l’intervention du salarié avaient un caractère exceptionnel.
Mais pour le juge, il s’agissait bien d’astreinte : le salarié devait être joignable à tout moment et disposait, à cette fin, du téléphone portable de l’entreprise. Et pour conformer cette position, le juge rappelle que le salarié a, en outre, déjà été sanctionné pour s’être montré injoignable alors que sa présence était requise pour une « assistance non programmée ».
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-23312
Salarié joignable à tout moment = salarié en astreinte ? © Copyright WebLex - 2017