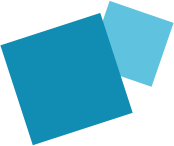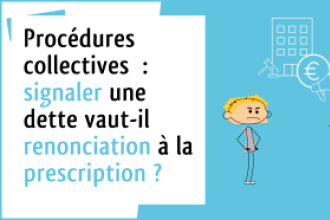C’est l’histoire d’un employeur qui se voit opposer sa propre page internet…

Après avoir été licencié, un serveur réclame au restaurateur qui l’employait le paiement d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées. Pour preuve, il met en avant, en plus des attestations de clients, la page internet du restaurant indiquant ses horaires d’ouverture…
Pour le salarié, qui estime avoir travaillé 6 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture du restaurant, cette page mentionnant les horaires d’ouverture est de nature à prouver l’existence des heures supplémentaires… Ce que conteste l’employeur : cette page internet ne fait qu’informer les clients sur l’amplitude d’ouverture du restaurant. Cette information ne peut suffire à prouver le temps de travail effectif du salarié, conteste l’employeur…
« Suffisant ! », au contraire, pour le juge : dans le cadre d’un litige portant sur l’existence des heures réalisées, le fait pour un salarié de transmettre les horaires d’ouverture du restaurant constitue un élément suffisamment précis qui oblige l’employeur à y répondre.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Un salarié, représentant du personnel, est mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours. Sauf qu’en raison de son statut protecteur, il estime que cette sanction nécessite son accord préalable…
Pour le salarié, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé au titre de son mandat de représentation. Or, cette sanction entraîne une modification de ses horaires et de sa rémunération. Parce qu’elle ne peut donc pas lui être imposée, il estime qu’il aurait dû être informé de son droit de refuser la sanction ! « Faux ! », réfute l’employeur : la mise à pied disciplinaire n’emporte pas de changement des conditions de travail du salarié. Même protégé, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié dans ce cas…
Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : une mise à pied à titre disciplinaire peut être imposée au salarié puisqu’elle ne suspend pas l’exécution de son mandat et ne modifie pas ses conditions de travail.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…
Les lecteurs ont également consulté…
Contrôle fiscal professionnel suivi d'un contrôle fiscal personnel : même cause, mêmes effets ?

Suite au contrôle fiscal de sa société au cours duquel l’administration a constaté qu’une dépense, déduite fiscalement, n’avait pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, un dirigeant subit un redressement fiscal « personnel » : l'administration considère que cette dépense constitue un « revenu réputé distribué » imposable à son niveau.
La procédure de contrôle fiscal menée à l’égard de sa société se révèle finalement être irrégulière. Le dirigeant en tire toutes les conclusions : pour lui, son redressement fiscal « personnel » est, lui aussi, de facto irrégulier.
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À tort
Les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard de la société est ici sans incidence sur la régularité du redressement fiscal portant sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées, en l'occurence ici le dirigeant.
Les lecteurs ont également consulté…
Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ?

Un intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise suivant 15 contrats successifs, tous mis en place pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité » qui a duré au total 8 mois ininterrompus...
Mais l'intérimaire demande la requalification de tous ces contrats de mission en un seul CDI, au motif que l'agence d'intérim n'a pas respecté les délais de carence qui doivent normalement s'écouler entre chaque contrat.
Sauf qu'ici, l'accroissement temporaire d'activité a eu lieu pendant 8 mois consécutifs : dans ce cas, aucun délai de carence ne s'applique entre 2 contrats de travail temporaire, se défend l'agence d'intérim...
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
L'accroissement temporaire d'activité ne constitue pas un motif dérogatoire au respect du délai de carence, qui doit obligatoirement s'écouler entre 2 contrats de mise à disposition.
À défaut, l'ensemble de la relation de travail pourra être requalifié en un seul contrat à durée indéterminée.
Les lecteurs ont également consulté…
Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

Des technologies ciblées par l’Union européenne
Parce que l’Union européenne (UE) a engagé une politique de soutien à l’investissement dans les technologies numériques et de rupture, des technologies propres et des biotechnologies, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale ont été revus à la hausse lorsqu’ils relèvent des « Technologies stratégiques pour l'Europe » (STEP).
Concrètement, lorsque les investissements concernent les technologies ciblées, les plafonds de cumul d'aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 M € sont augmentés de 10 points pour Mayotte, la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique.
Pour les autres territoires, listés ici, les plafonds ont été augmentés de 5 points.
Attention, il existe des différences de plafonds entre les territoires et la taille de l’entreprise, disponibles ici.
Notez que, pour les grands projets d’investissement éligibles des entreprises de plus de 50 M €, les modalités de calcul pour déterminer le montant maximal de l’aide ont été modifiées.
Enfin, les seuils de notification des aides à finalité régionale en fonction des intensités d’aide des zones, disponibles ici, ont également été mis à jour.
Les lecteurs ont également consulté…
Notaire – Taux de cotisation de la garantie collective - Année 2025
Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme qui prévoit la solidarité entre tous les notaires. En cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.
Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2025 afin de financer cette garantie collective est fixé à 0,13 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.
Les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 200 000 € bénéficient d’une décote dans les limites ci-après :
- pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, la décote est de 50 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, la décote est de 25 %.
Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

Inopposabilité des actes du débiteur : seulement en cas de passif à combler ?
Pour rappel, la procédure de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur désigné. Concrètement, l’entrepreneur ne peut plus, par exemple, vendre un bien ou mettre fin à un contrat.
S’il le fait malgré tout, ses actes sont dits inopposables à la procédure, et donc au liquidateur judiciaire.
Une situation qui a un écho dans une affaire récente…
Une société mise en liquidation judiciaire dispose d’un compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique et de services de paiement.
Le liquidateur judiciaire demande à l’établissement de clôturer ce compte et de lui remettre le solde créditeur.
Demandes exécutées par l’établissement, qui verse au liquidateur un solde, inférieur à ce qu’il devrait être : depuis l’ouverture de la procédure collective, en effet, des débits ont été faits sur le compte par la société en liquidation, pourtant dessaisie de ses pouvoirs.
Ce qui n’a pas d’importance, selon le liquidateur judiciaire, puisque les actes ainsi réalisés par le débiteur sont inopposables à la procédure collective. Il réclame donc à l’établissement de lui reverser le solde du compte tel qu’il aurait dû être sans l’intervention de la société.
Mais l’établissement refuse : parce que l’inopposabilité permet de protéger l'intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur a déjà assez d’actifs pour les rembourser, il n’y a pas de raison d’appliquer la règle d’inopposabilité et de réclamer les sommes débitées par la société.
Argument que réfute le liquidateur : sa mission est, certes, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais aussi, et peut-être surtout, de reconstituer le patrimoine du débiteur. Peu importe donc de savoir s’il dispose de suffisamment d’actifs pour combler le passif pour appliquer l’inopposabilité des actes qui n’auraient pas dû être pris.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du liquidateur : les actes de disposition effectués par la société pourtant dessaisie sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective. Inopposabilité dont le liquidateur peut se prévaloir, peu importe l’état du passif et de l’actif !
Les lecteurs ont également consulté…
Épargne salariale : une nouvelle rubrique fait son entrée dans le BOSS !

Une nouvelle rubrique opposable depuis le 1er février 2025 :
Une nouvelle rubrique relative à l’épargne salariale vient tout juste d’être ajoutée au BOSS, au sein du chapitre dédié « aux autres éléments de rémunération ».
Pour l’heure, cette rubrique ne compte qu’un seul chapitre sur la Prime Partage de la valeur (PPV).
Outre ses modalités de versement, cette nouvelle rubrique contient ainsi différentes précisions, notamment quant aux modalités d’affectation de la PPV sur un plan d’épargne ou sur les modalités d’abondement de la prime.
Jusqu’alors, la rubrique dédiée à la PPV existait sous forme d’un question-réponse, intégré au bloc « mesures exceptionnelles ».
Sa pérennisation conduit désormais l’administration à l’intégrer à cette nouvelle rubrique.
Notez que cette foire aux questions qui était jusqu’alors accessible dans le bloc « Mesures exceptionnelles » reste accessible afin de présenter les modalités de sa mise en œuvre avant le 1er janvier 202. D’autres chapitres devraient prochainement venir compléter cette rubrique.