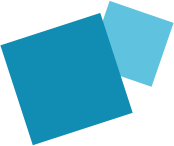Entretien préalable : et s’il s’agissait d’un salarié protégé ?

Convocation à l’entretien préalable : une date-clé
Si vous ne savez pas que votre salarié est titulaire d’un mandat externe (conseiller, prud’homal, par exemple), il doit vous en informer, au plus tard, le jour de l’entretien préalable à son licenciement afin de bénéficier de la protection que lui confère ce mandat.
En revanche, si vous savez, au moment où vous envoyez la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement, que votre salarié peut prétendre à cette protection, vous devrez, quoi qu’il arrive, demander l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement. La preuve avec ces 2 illustrations.
- 1er exemple : une salariée manifeste son intention de se présenter aux élections professionnelles…
Une entreprise est sur le point d’organiser les élections des représentants du personnel. Une salariée informe son employeur qu’elle souhaite se présenter à ces élections. Elle est convoquée quelques jours plus tard à un entretien préalable, puis licenciée le jour de la date butoir de présentation des candidatures.
Ce qu’elle conteste, au motif que l’employeur aurait dû demander l’autorisation de l’inspecteur du travail pour prendre sa décision. Ce que conteste, à son tour, l’employeur : parce qu’elle n’a pas effectivement présenté sa candidature dans le délai prévu, elle ne peut pas bénéficier de la protection des représentants du personnel et des candidats à leur élection, selon lui.
Faux, dit le juge qui rappelle que, si au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, l’employeur a connaissance de la candidature d’un salarié ou de son imminence, il doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier le salarié concerné. Parce que l’employeur n’a pas sollicité cette autorisation ici, le licenciement est nul.
- 2ème exemple : un salarié perd son statut de représentant de section syndicale, suite à une décision de justice...
Un salarié est désigné représentant de section syndicale. L’employeur conteste cette désignation en justice. Et, pour d’autres considérations liées à la relation de travail, il décide de licencier ce salarié et le convoque à un entretien préalable
Quelques jours plus tard, et avant même la date de l’entretien, le juge annule la désignation du représentant de section syndicale. Le salarié ayant alors perdu son statut protecteur, l’employeur ne sollicite pas l’autorisation de l’inspecteur du travail.
A tort, selon le salarié… et selon le juge qui rappelle que l’annulation de la désignation n’est pas rétroactive : le salarié perd donc son statut protecteur au jour de la décision de justice, qui est postérieur à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable. Parce qu’à ce jour précis le salarié bénéficiait de la protection liée à son mandat, l’autorisation de l’inspecteur du travail était requise.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-10139
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-11048
Entretien préalable : et s’il s’agissait d’un salarié protégé ? © Copyright WebLex - 2017

VRP un jour, VRP toujours ?

Mention « VRP » dans le contrat de travail : déterminante ?
Un ancien salarié réclame à un employeur le bénéfice de son statut de VRP, au moment de son licenciement. Statut que lui refuse l’employeur. A tort, selon le salarié, puisque son contrat de travail mentionne expressément qu’il est VRP.
Certes, répond l’employeur, mais ce statut ne correspond pas aux fonctions réellement exercées, à présent, par le salarié : son contrat de travail a été signé il y a 25 ans mais depuis 23 ans, le salarié exerce des fonctions de « responsable de secteur » qui n’impliquent aucune prospection, ni aucune prise de commande. N’exerçant pas ces tâches qui correspondent à un emploi de VRP, le salarié ne peut pas prétendre à ce statut, estime-t-il.
A tort, selon le juge : puisque ce statut lui a été reconnu dans son contrat de travail et qu’aucun avenant ne l’a remis en cause, le salarié le conserve.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-13478
VRP un jour, VRP toujours ? © Copyright WebLex - 2017

Défenseur syndical : rémunéré par qui ?

Un maintien de salaire… potentiellement remboursé
Le temps pendant lequel le défenseur syndical exerce sa mission d’assistance et de représentation est rémunéré par son employeur. Ce dernier doit, en effet, maintenir le salaire du défenseur syndical en mission, ainsi que l’ensemble de ses avantages.
Mais s’il en fait la demande, l’employeur peut être remboursé de l’intégralité de ces sommes, y compris des charges sociales y afférant, par l’Etat. Pour cela, il doit adresser sa demande à l’Agence de services et de paiement, assortie des justificatifs suivants :
- la copie du bulletin de paie du salarié correspondant au mois de la demande ;
- l'imprimé de demande de remboursement des salaires maintenus, dont le modèle est établi par le ministère chargé du travail (arrêté non paru à ce jour).
S’il s’agit de votre première demande, n’oubliez pas d’ajouter :
- votre RIB ;
- selon la nature de l’employeur :
- ○ l'extrait K original du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois pour un commerçant ;
- ○ l'extrait D1 original du registre des métiers de moins de 3 mois pour un artisan ;
- ○ l'extrait K bis original de moins de 3 mois de la société ;
- ○ la copie du récépissé de déclaration de l'association à la préfecture ;
- ○ la copie de la carte d'identité professionnelle pour une profession libérale.
Si le salarié qui exerce les fonctions de défenseur syndical est rémunéré exclusivement à la commission, vous devrez lui remettre une attestation de revenus. C’est en effet au salarié commissionné qu’il appartient de faire la demande d’indemnisation à l’Etat.
Source : Arrêté du 25 octobre 2017 relatif aux modalités de remboursement et d'indemnisation liées à l'activité de défenseur syndical
Défenseur syndical : rémunéré par qui ? © Copyright WebLex - 2017

Employés administratifs : aussi exposés à l’amiante ?

Protéger de l’exposition fonctionnelle et environnementale à l’amiante
Un arrêté ministériel place une entreprise industrielle sur la liste des entreprises visées par les préretraites amiante. Un salarié de cette entreprise y voit là une opportunité d’être indemnisé de son préjudice d’anxiété.
Refus de l’employeur : ce salarié, exerçant des fonctions administratives sans lien avec la production des pièces contenant de l’amiante, n’a jamais été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante. De ce fait, aucune indemnisation ne lui est due, estime l’employeur.
A tort, pour le juge : si cette entreprise figure sur la liste des entreprises concernées par la préretraite amiante, c’est qu’elle n’a pas pris les moyens suffisants pour assurer la sécurité de ses salariés et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Son salarié se trouvait donc dans un état d’inquiétude permanent face au risque de développer, à tout moment, une maladie liée à l’amiante, peu importe que la nature de son exposition soit fonctionnelle ou environnementale.
L’entreprise doit donc verser à ce salarié une indemnisation de 2 000 € pour 1 an et demi d’exposition environnementale.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-21708
Vie professionnelle, vie personnelle : une frontière parfois mince

Accident lors d’une mission = accident de travail ?
Dans une 1ère affaire, un salarié s’est blessé dans une boîte de nuit, à 3 heures du matin, alors qu’il était en déplacement professionnel à l’étranger. La Sécurité sociale estime qu’il s’agit d’un accident de travail, ce que conteste l’employeur pour qui cette reconnaissance impactera nécessairement son taux de cotisation AT/MP.
Pour l’employeur, certes le salarié était à l’étranger pour des raisons professionnelles mais, s’il dansait en boîte de nuit, à 3 heures du matin, ce n’était certainement pas dans le cadre de ses fonctions. De ce fait, l’accident survenu ne peut pas être considéré, selon l’employeur, comme un accident de travail.
Faux, répond le juge qui confirme la position de la Sécurité sociale : pendant tout le temps de sa mission, le salarié doit être protégé contre les risques d’accident de travail, peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. Pour exclure la qualification d’accident de travail, il appartient à l’employeur ou à la caisse de Sécurité sociale de prouver que le salarié a interrompu sa mission pour des motifs personnels.
Or, le seul fait que le salarié se trouve dans une discothèque ne suffit pas à prouver l’absence de lien avec son activité professionnelle : il aurait très bien pu accompagner des clients ou des collaborateurs, ou tout simplement répondre à une invitation dans le cadre de sa mission. C’est pourquoi, faute d’apporter la preuve contraire, cet accident doit être considéré comme un accident de travail.
Incident lors d’un séminaire= incident professionnel ?
Dans une autre affaire, une entreprise organise un séminaire de 2 jours dans une station balnéaire. A l’occasion de la soirée qui sépare ces 2 jours, un responsable d’équipe propose à ses collaborateurs de manger au restaurant, d’aller ensuite en discothèque, puis de prolonger la soirée sur la plage.
C’est alors que les salariés ont chahuté et que l’un d’eux a blessé une collègue en la jetant à l’eau, blessure qui lui a occasionné un mois d’arrêt de travail et a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail.
Mais l’employeur estime que, parce que le responsable d’équipe a laissé ses collaborateurs chahuter, permettant ainsi cet incident, et parce qu’il n’a pas jugé utile de sanctionner le salarié à l’origine des blessures de la victime, ce manager a commis des manquements qui justifient son licenciement. Ce que le responsable d’équipe conteste. Pour lui, le temps pendant lequel est survenu l’incident relève de sa vie privée.
Ce que confirme le juge qui précise que le licenciement motivé par un événement relevant de la vie privée d’un salarié et qui n’impacte pas la qualité du travail est sans cause réelle et sérieuse.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-22481
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-15030
Transaction : un « bon » moment pour discuter ?

Transaction : à signer après la rupture du contrat !
Une entreprise signe une transaction avec son ancien directeur, révoqué de son mandat social puis licencié. Ce dernier va finalement contester la transaction. Si cette transaction est effectivement annulée, il pourra prétendre à des indemnités pour licenciement abusif.
Il soutient, à cette fin, que le projet de transaction lui a été présenté avant que son licenciement ne soit prononcé. Or, rappelle-t-il, toute transaction dont le contenu serait dévoilé avant le licenciement est nulle.
Mais le juge précise que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique que le salarié et l’employeur discutent ensemble préalablement d’un projet de protocole. Pour cette raison et parce que l’ancien salarié n’apporte pas la preuve que la transaction a été signée avant la notification de son licenciement, cette transaction est valable, d’autant qu’elle prévoyait une indemnité conséquente (plus de 32 000 €).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-16676
Transaction : un « bon » moment pour discuter ? © Copyright WebLex - 2017

Indemnités kilométriques : obligatoire pour toute utilisation d’un véhicule personnel !

Indemnités kilométriques et mise à disposition de véhicules : cumulables ?
Une entreprise emploie un ouvrier agricole, qui, pour l’exécution de son travail, effectue des déplacements. Parce qu’il utilise, à cette fin, son véhicule personnel, il réclame à son employeur des indemnités kilométriques.
Ce que ce dernier lui refuse au motif qu’il met plusieurs voitures à la disposition de son salarié pour ses déplacements. Certes, rétorque le salarié, mais son contrat de travail lui impose, pour se rendre sur les différents lieux de travail, d’utiliser son véhicule personnel. C’est pourquoi, selon lui, l’employeur doit lui verser des indemnités kilométriques.
Ce que confirme le juge qui rappelle que ces indemnités sont dues au salarié qui utilise effectivement son véhicule personnel, peu importe que l’employeur mette alors à sa disposition d’autres véhicules. Et parce que son contrat de travail impose l’utilisation de son véhicule personnel et que l’employeur ne prouve pas que le salarié a agi autrement, l’employeur doit lui verser des indemnités kilométriques.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-18330
Indemnités kilométriques : « quelle voiture utilisez-vous ? » © Copyright WebLex - 2017

Santé et sécurité au travail : une surface minimale de travail ?

Des normes pour respecter votre obligation de sécurité !
La loi ne prévoit pas les dimensions ou la surface idéale d’un espace de travail. Elle se contente de rappeler que les travailleurs doivent pouvoir exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
Elle ajoute que l’espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante. Si certains postes ne permettent pas cette liberté de mouvement, un espace libre doit être organisé à proximité.
Mais si la Loi est muette sur la surface idéale des espaces de travail, il existe tout de même des normes qui permettent, si elles sont appliquées, de concevoir des locaux dans le respect de votre obligation de sécurité. Ces normes, consultables auprès de l’Afnor, sont d’application volontaire, c’est-à-dire qu’elles ne s’imposent pas à vous, mais constituent de simples outils de conception du lieu de travail. A cette fin, vous pouvez aussi consulter les fiches pratiques de l’INRS et vous rapprocher de votre service de santé au travail.
Toutefois, n’en déduisez pas qu’il est possible de faire travailler un salarié dans un placard, même spacieux ! Car le local de travail doit être, chaque fois que la nature de l’activité ne s’y oppose pas, muni de baies vitrées permettant l’éclairage naturel.
Source : Réponse Ministérielle Gremillet, Sénat, du 5 octobre 2017, n° 00683
Un salarié au placard, au sens propre comme au figuré ? © Copyright WebLex - 2017

Appliquer une convention collective : un choix forcé ?

Application volontaire : volonté claire et non équivoque
Un salarié réclame le paiement d’une indemnité de non-concurrence à son entreprise, qui exploite une activité d’orthopédie, et dont le montant est prévu par la convention collective de la métallurgie. Convention collective inapplicable à l’entreprise, rétorque l’employeur : les entreprises d’orthopédies, telles que celle qu’il exploite, ne sont pas soumises à cette convention collective.
Sauf que le salarié rappelle :
- d’une part, que son contrat de travail mentionnait qu’il occupait un poste « d’applicateur », métier qui fait référence à l’application de métaux ;
- d’autre part, que ses bulletins de paie mentionnaient tous un coefficient correspondant à celui de la convention collective de la métallurgie.
Ces mentions prouvent bien, selon lui, que l’employeur entendait volontairement lui appliquer cette convention collective. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-12586
Appliquer une convention collective : un choix forcé ? © Copyright WebLex - 2017

Rupture conventionnelle : attention aux erreurs « matérielles » !

Un délai de réflexion impératif !
Une entreprise et un salarié concluent une rupture conventionnelle, le 15 octobre. Alors que la rupture est homologuée par l’administration (la Direccte), le salarié considère, quant à lui, qu’elle est nulle et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La convention mentionne, en effet, un délai de rétractation expirant le 30 septembre, date antérieure à la signature du contrat.
« Erreur manifestement matérielle » qui n’entraîne pas pour autant la nullité de la convention, répond l’employeur. Sauf que la convention a été envoyée à l’administration le 23 octobre, et donc avant l’expiration du délai de rétractation…
Privant ainsi le salarié de la possibilité de se rétracter, constate le juge. Or, cette faculté de rétractation est une garantie qui conditionne la validité de la convention. Faute de l’avoir accordée au salarié, la rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit donc indemniser le salarié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 15-27708
Rupture conventionnelle : attention aux erreurs « matérielles » ! © Copyright WebLex - 2017