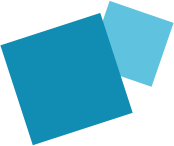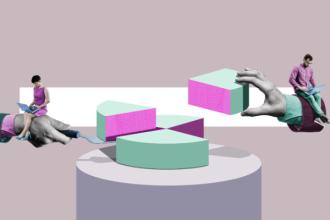Licenciement : quand supérieur rime avec employeur…

Quand un supérieur hiérarchique sans pouvoir disciplinaire est au courant de certaines choses…
Une salariée, directrice adjointe, est licenciée pour faute grave en avril en raison de fautes commises en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariés ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité.
Ce qu’elle conteste : selon elle, sa supérieure hiérarchique, à savoir la directrice générale, était au courant des faits reprochés bien avant le prononcé de son licenciement.
C’était notamment le cas pour les heures supplémentaires, acomptes ou congés validés par cette même supérieure au cours de l’année précédant celle du licenciement.
Dès lors, la salariée considère que ces faits litigieux sont prescrits et ne peuvent pas être invoqués pour justifier son licenciement pour faute grave.
Ce dont l’employeur se défend : il rappelle que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés.
Et parce que la directrice générale n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, sa connaissance des faits ne faisait pas courir ce délai de prescription…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur, au sens de la prescription des faits fautifs, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société qui préfère s’occuper elle-même de sa pub…

Une personne affiche sur un panneau publicitaire un texte critique à l’égard d’une société qui y est nommément désignée. Heureuse du résultat, elle en publie même des photos sur les réseaux sociaux. Avertie et s’estimant lésée, la société réagit…
… et porte plainte pour reproduction et usage d’une marque déposée. Sauf que, pour caractériser un tel délit, il faut que l’affichage soit fait dans le cadre d’une activité professionnelle et dans le but d’en tirer profit, conteste la responsable de l’affichage décrié… qui, justement, possède et travaille dans une agence de publicité, conteste la société. « Certes », répond sa contradictrice, mais l’agence n’est pas impliquée, le panneau publicitaire lui appartenant personnellement. Et elle n’a tiré aucun profit de ses actes qui n’avaient pour seul objectif que la satire…
Ce que valide le juge : ici, tout a été fait à partir de moyens personnels et sans aucune intention d’en tirer des profits économiques. Aucune sanction n’est donc encourue !
Les lecteurs ont également consulté…
Vente d’une maison… et de son terrain : 2 exonérations pour le prix d’une ?

Un couple vend sa résidence principale, ainsi que le terrain qui y est accolé. Sauf que cette vente est réalisée au profit de 2 acheteurs différents : un pour la maison et un pour le terrain attenant.
S’il n’a pas de doute sur le fait que la plus-value liée à la vente de sa résidence principale est exonérée d’impôt, il se demande si cette exonération s’étend à la vente du terrain.
D’après vous ?
La bonne réponse est... La vente du terrain est exonérée, comme la maison
Les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale dont la vente est exonérée d’impôt sont également exonérées à la condition que leur vente intervienne simultanément avec celle de la résidence principale.
Lorsque l'immeuble n'est pas vendu comme terrain à bâtir, il est admis que l'exonération applicable aux dépendances immédiates et nécessaires porte sur l'ensemble du terrain entourant la maison, quelle que soit sa superficie.
La circonstance que la vente soit réalisée au profit d'acheteurs distincts ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération, toutes conditions étant par ailleurs remplies, pour autant que la vente des dépendances intervienne simultanément avec la maison ou dans un délai rapproché.
Les lecteurs ont également consulté…
Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…

Licenciement économique : poste disponible = poste de reclassement ?
Une salariée qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est licenciée pour motif économique le 24 février.
Mais elle conteste finalement le bienfondé de ce licenciement parce que, selon elle, son employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.
Pour preuve, elle fait valoir le fait qu’une filiale de son entreprise a procédé à une embauche 2 mois seulement après son licenciement… pour un poste d’agent administratif compatible avec son profil.
Or ce poste aurait dû lui être proposé ! Puisque cela n’a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce que réfute l’employeur ! Pour se défendre, il rappelle qu’au titre de son obligation de reclassement il doit proposer les postes disponibles au jour où il notifie la rupture à la salariée.
Et justement, le 24 février, jour de cette notification, le poste litigieux n’était pas encore disponible ! Il ne s’est libéré qu’après la notification du licenciement pour motif économique.
Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement ou d’avoir orchestré cette indisponibilité…
Ce qui emporte la conviction du juge : l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisque rien ne démontre qu’il avait connaissance du fait que ce poste allait se libérer postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique.
Les lecteurs ont également consulté…
Accident du travail : une déclaration impérative !

Accident du travail = déclaration (même avec réserves)
Alors qu’elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.
Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…
Pour l’employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l’accident n’est pas d’origine professionnelle.
Et puisque cette chute n’a pas pour cause le travail, l’employeur considère qu’il n’a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Ce que conteste la salariée : sa chute s’est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l’autorité de son employeur. Il s’agit donc bel et bien d’un accident du travail que l’employeur est tenu de déclarer pour qu’elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.
Surtout, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu’il peut émettre sur l’origine professionnelle de l’accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l’employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l’entreprise, survenu à l’occasion du travail, et dont il a eu connaissance.
Ce n’est qu’après avoir dûment déclaré l’accident auprès de la CPAM que l’employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ?

Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !
Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.
Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.
Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…
Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.
Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.
Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Les lecteurs ont également consulté…
Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?

Résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré : possible ?
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés voient leurs contrats de travail transférés vers une autre entreprise, qui en devient cessionnaire.
Mais parce qu’ils reprochent des fautes à leur ancien employeur, de nature à créer un préjudice indemnisable, 2 salariés réclament résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leur ancien employeur.
Selon eux, ce n’est pas parce que leur contrat a été transféré vers un nouvel employeur qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir contre leur ex-employeur.
Ce qui pose question : les salariés peuvent-il agir en résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré uniquement envers leur ancien employeur, tout en continuant la relation de travail avec leur employeur actuel ?
« Non ! » tranche le juge : d’abord parce que les dispositions du Code du travail en matière de transfert des contrats de travail sont d’ordre public et s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.
Ensuite, si le transfert de contrat ne prive pas le salarié de tout droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut pas se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat…tout en conservant le bénéfice de ce même contrat, transféré au nouvel employeur.
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à un comportement qui frise le harcèlement moral…

Informé par les représentants du personnel et par des salariés du comportement inapproprié d’une directrice, entraînant pour les collaborateurs une souffrance au travail, un employeur décide de la licencier pour faute grave. Un licenciement contesté par la salariée…
Ce que lui reproche l’employeur s‘apparente à du harcèlement moral. Or, aucun élément ne prouve que l'employeur ait cherché à vérifier que les faits qui lui étaient rapportés étaient effectivement constitutifs d’un harcèlement moral qui pourrait lui être imputable. Et, preuve supplémentaire selon elle, il n’a diligenté aucune enquête interne et n’a engagé la procédure disciplinaire qu’un mois après avoir reçu les courriers de dénonciation. Pour la salariée, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse…
Licenciement au contraire justifié, estime le juge : son seul comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise, validant ainsi la faute grave. Prouver des faits de harcèlement ne changerait rien…
Les lecteurs ont également consulté…
Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?

Pas de numéro Siren = pas de personnalité juridique ?
Une SCI signe avec une société par actions simplifiée (SAS) une « promesse synallagmatique de vente et d’achat » d’un immeuble. Autrement dit, la SCI s’engage à vendre l’immeuble à la SAS tandis que la SAS s’engage à le lui acheter.
Malheureusement, la vente n’aboutit pas en raison d’un litige né entre les 2 sociétés, et la SAS réclame à la SCI des dommages-intérêts.
Pour garantir cette créance, la SAS fait inscrire une « hypothèque judiciaire » sur l’immeuble de la SCI. Concrètement, cela signifie que, grâce à cette hypothèque autorisée par le juge, la SAS a le droit, si elle n’est pas payée, d’obtenir son argent en réclamant la vente du bien hypothéqué.
« Non ! », conteste la SCI qui se défend en remettant en cause l’existence même de la promesse de départ. Pourquoi ? Parce que la SAS n’avait pas de numéro Siren, c’est-à-dire de numéro d’identification attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Pour rappel, une société a « une personnalité juridique », c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une personne avec des droits, des obligations, un patrimoine, capable de s’engager dans un contrat ou d’aller en justice.
Or, selon la SCI, puisque la SAS n’avait pas ce numéro, elle n’était pas encore dotée de cette personnalité juridique : elle ne pouvait donc pas signer valablement le contrat. Une raison, à ses yeux, pour faire annuler l’hypothèque qui pèse sur son immeuble…
« Non », tranche le juge en faveur de la SAS : certes, le numéro Siren est important car il permet l’identification de la société auprès des administrations, mais une société est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et non au moment de l’attribution de son numéro Siren. L’hypothèque n’est donc pas annulée !
Les lecteurs ont également consulté…
Un vol… imposable ?

Indemnité d’assurance : une imposition qui compense des déductions ?
Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d'un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.
Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.
Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante.
En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l'exonération d'impôt de l'indemnité d'assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l'entreprise.
Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d'un bien inscrit à l'actif immobilisé, le montant de l'indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n'est non plus due dans ce cas (la part de l'indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).
Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.